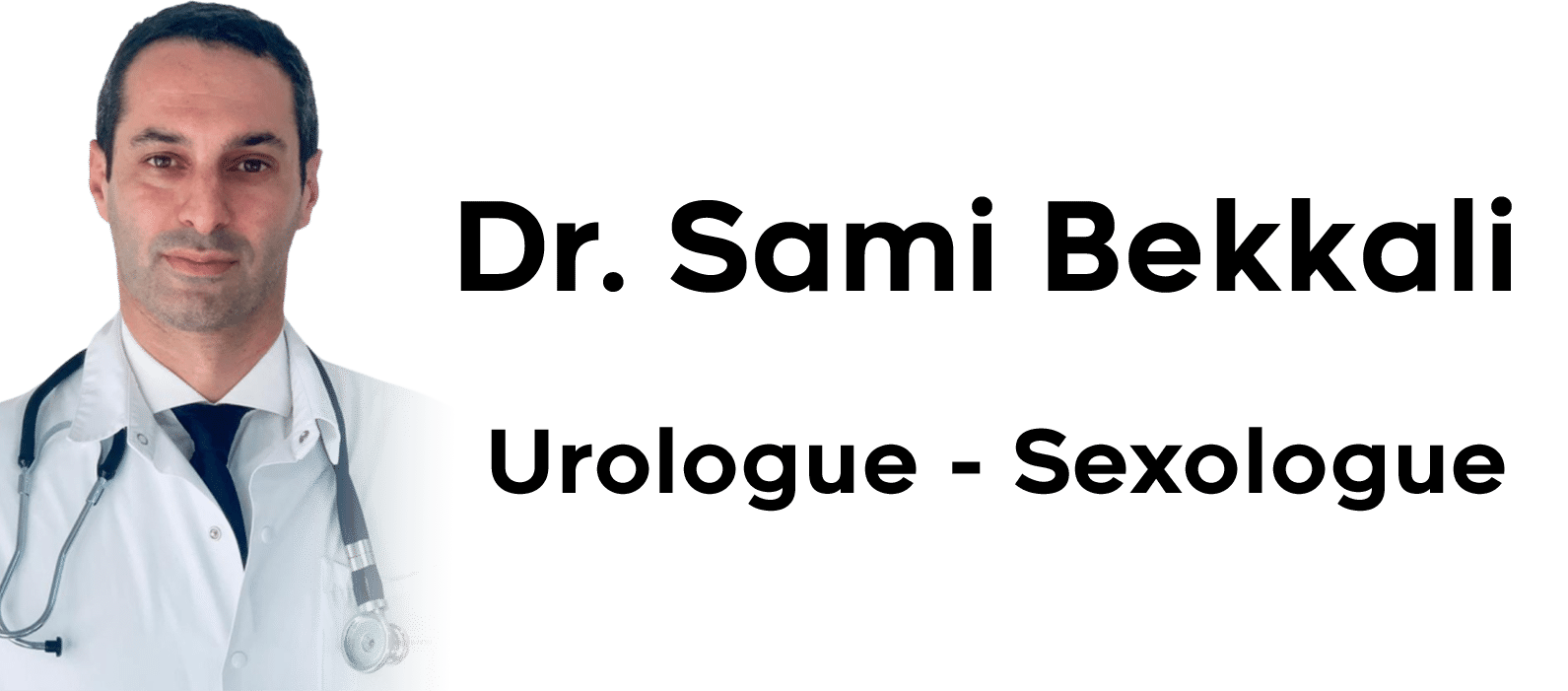I – DEFINITION
L’insuffisance rénale aiguë (IRA) est caractérisée par une dégradation de la fonction excréto- rénale survenant de façon brutale ou rapidement progressive en quelques heures à quelques jours.
notera que la définition de l’insuffisance rénale aiguë ne fait appel à aucun critère de diurèse : La diurèse peut être conservée ou diminuée (oligurie si < 400 ml/j ou anurie si < 100 ml/j).
Conséquence :
- Rétention azotée par incapacité des reins à éliminer les déchets métaboliques terminaux.
- Désordres hydroélectrolytiques nombreux (acidose métabolique, hyperkaliémie, hyperhydratation).
Il n’existe aucune définition de l’IRA au sens strict du terme.
De façon générale, on retient comme définition
- une élévation de plus de 50 % de la créatininémie par rapport à la valeur basale
- ou une réduction de la clairance de la créatinine calculée selon la formule de Cockcroft de 50 % par rapport à la valeur basale.
EPIDEMIOLOGIE GENERALE
- Le diagnostic étiologique d’une insuffisance rénale aiguë est une urgence.
- par ordre de fréquence l’IRA fonctionnelle (70 %), puis l’obstacle (17 %) et les atteintes toxiques médicamenteuses et infectieuses (11%).
- Le taux de mortalité reste de l’ordre de 15 %, variant suivant l’étiologie de l’IRA de 7 à 55%, cependant meilleur que celui des IRA de recrutement hospitalier, volontiers multifactorielles (autour de 60 % de mortalité).
II – CIRCONSTANCES ETIOPATHOGENIQUES
Les causes de l’IRA ont été arbitrairement classées en 3 grandes catégories comme suit :
- l’insuffisance rénale fonctionnelle (IRF),
- l’insuffisance rénale parenchymateuse organique,
- l’IRA d’origine obstructive.
Ces 3 grands différents mécanismes peuvent s’intriquer notamment en cas d’IRA survenant après chirurgie.
2-1 IRF
- une altération de la fonction rénale sans lésion histologique en rapport avec une diminution de la perfusion rénale.
- rapidement réversible lorsqu’elle est isolée si la cause est traitée.
- secondairement à une hypoperfusion rénale et témoigne de la diminution de la filtration glomérulaire. Les mécanismes d’adaptation de la perfusion rénale (vasodilatation de l’artériole afférente et vasoconstriction de l’artériole efférente), permettent de maintenir une filtration glomérulaire correcte jusqu’à une pression artérielle systolique de 80mmHg. En deçà, l’hypoperfusion rénale induit une chute du débit de filtration glomérulaire et une insuffisance rénale apparaît.
- Les mécanismes d’adaptation peuvent cependant être plus rapidement dépassés en cas de pathologie des artères rénales, de prise d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou d’anti-inflammatoires non stéroïdiens
- Les patients âgés sont particulièrement susceptibles à l’IRF car ils présentent une prédisposition à l’hypovolémie (diminution de la sensation de soif ou de l’accès aux boissons, régime sans sel intempestif) ainsi qu’une prévalence importante de l’athérome (sténose de l’artère rénale…) qui favorise l’ischémie rénale
- Circonstances déclenchantes des IRF
1-Déshydratation extracellulaire
- Origine extrarénale : digestive ou sudorale
- Origine rénale : diurétiques, néphropathie avec perte de sel, insuffisance surrénale aiguë, diabète décompensé
2-Hémorragie
3–”Hypoperfusion rénale sans hypovolémie”
- Insuffisance cardiaque aiguë
- Syndrome néphrotique
- Insuffisance hépatique
- Choc septique
4–Modification de l’hémodynamique intrarénale avec baisse de la pression dans les capillaires glomérulaires et effondrement du débit de filtration glomérulaire
- Inhibiteur de l’enzyme de conversion par blocage de la vasoconstriction de l’artériole efférente du glomérule (en cas de sténose artérielle rénale ou après anesthésie)
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens par inhibition de la formation des prostaglandines vasodilatatrices agissant sur l’artère afférente du glomérule.
2-2 INSUFFISANCE RENALE OBSTRUCTIVE OU POSTRENALE
- L’anurie par obstacle de la voie excrétrice est définie comme un arrêt total ou presque total de la diurèse (< 400ml/24 h) due à une obstruction située à un niveau quelconque de la voie excrétrice supérieure, orifices urétéraux compris (donc vessie vide).
- l’obstacle urétéral peut être bilatéral ou unilatéral sur rein unique anatomique ou fonctionnel. Il peut également être situé sur le bas appareil urinaire s’accompagnant
- alors d’une rétention vésicale Il peut être complet ou incomplet.
- Il s’agit d’une urgence médicale car le pronostic vital est engagé (insuffisance rénale aiguë).
- Le diagnostic précis de la nature obstructive est nécessaire avant d’envisager un traitement qui pourra conduire à une guérison définitive ou qui ne pourra malheureusement empêcher une évolution fatale dans 20 % des cas.
- La possibilité de récupération de la fonction rénale est généralement inversement liée à la durée de l’obstruction.
- Une dilatation des voies urinaires peut être absente en cas de déshydratation extracellulaire importante ou de fibrose rétropéritonéale.
- L’atteinte est consécutive à une hyperpression dans le tube contourné proximal, à une infiltration cellulaire interstitielle, à une modification des mécanismes de concentration-dilution
Principales étiologies des insuffisances rénales aiguës obstructives
Obstacle intraluminal :
- lithiase calcique ou urique
- caillot
- nécrose capillaire
Obstacle pariétal par néoplasie urothéliale
Obstacle externe par compression :
- origine prostatique (adénome ou cancer)
- néoplasie utérine
- tumeur colorectale
- fibrose rétropéritonéale (néoplasie ou médicaments)
Vessie neurologique
IRA “microobstructive” par précipitation intratubulaire de :
- Urate ou phosphate en cas de lyse tumorale après chimiothérapie
- Chaînes légères en cas de myélome
- médicaments acyclovir, antirétroviraux, triamtérène, sulfamides,…
anuries néoplasiques
- cancers de la prostate (25 %) ;
- cancers de la vessie (23 %) ;
- cancers génitaux (35 %) ;
- cancers digestifs (15 %).
– infiltration rétro trigonale bloquant les uretères à leur abouchement dans la vessie d’origine vésicale ou prostatique.
– poussée inflammatoire et oedémateuse péri néoplasique.
– développement rapide d’adénopathies cancéreuses ou inflammatoires.
– sclérose cicatricielle post-radiothérapie.
– cancer de l’utérus, de l’ovaire, du rectum. Prostatique, vésical,
Conséquences physiopathologiques :
- Modifications morphologiques
- Les calices : L’obstruction pure sans infection associée provoque un aplatissement des fonds des calices qui deviennent ensuite régulièrement convexes. Tandis que les pieds des calices s’élargissent et que l’ensemble des calices s’écartent les uns des autres, l’ensemble de ces caractères permet de distinguer l’obstruction des anomalies calicielles au cours d’autres affections et principalement de la pyélonéphrite chronique, où les pieds des calices ne sont pas dilatés et restent proches les uns des autres
- Le bassinet : Il augmente de volume et devient convexe sur ses 2 bords
- L’uretère : L’hyperpression produit une augmentation de la taille de l’uretère dans ses trois dimensions
- Modifications du fonctionnement rénal au cours de l’obstruction
- Variations du débit sanguin rénal au cours de l’obstruction
- En cas d’obstruction urétérale unilatérale.
- Dès l’obstruction, on constate une augmentation du débit sanguin rénal, alors que le débit du rein controlatéral n’est pas modifié. due à une vasodilatation des artérioles efférentes.
- Au bout de quelques heures d’obstruction, chute de débit sanguin rénal due à une vasoconstriction des artérioles préglomérulaires.
- En cas d’obstruction urétérale bilatérale l’augmentation du débit sanguin rénal est plus importante, plus durable et la chute du débit par vasoconstriction des artérioles afférentes plus lente.
- En cas d’obstruction urétérale unilatérale.
- Altérations du fonctionnement du néphron
-
- Le rein obstrué présente un métabolisme modifié puisqu’il se fait complètement ou en partie en anaérobiose.
- une augmentation de la pression dans les voies excrétrices déclenche la synthèse intrarénale de prostaglandines vasodilatatrices (PGE2), responsable d’une augmentation de la filtration glomérulaire. Puis, le système renine-angiotensine est stimulé par l’action des prostaglandines, et l’action de l’ADH est également antagonisée par la PGE2. Ceci concourre à maintenir l’hyperpression dans les cavités pyélocalicielles
- L’élévation de la pression hydrostatique tubulaire Pt qui peut atteindre 80 mmHg à 100 mmHg entraîne un arrêt de la filtration glomérulaire malgré une augmentation du débit sanguin rénal par vasodilatation et donc une augmentation de la Pression capillaire Pc glomérulaire.
- Cependant la filtration glomérulaire ne va pas rester nulle durant toute la période d’obstruction. L’urine du bassinet serait en partie résorbée par diverses voies : veineuse, lymphatique, tubulo-interstitielle.
- >> La reprise de la filtration glomérulaire au cours de l’obstruction complète si elle est relativement importante (environ 10 ml/mn) tant que le rein n’est pas détruit, deviennent nulle lorsque le rein est fonctionnellement détruit, au bout de six à huit semaines environ.
-
- La reprise fonctionnelle des reins exclus
-
- polyurie osmotique avec perte de sel
- 3 principaux facteurs intriqués
- L’état physio-pathologique entraîné par l’insuffisance rénale aiguë. accumulation d’eau et de substances dissoutes, en particulier des catabolites azotés
- tubulopathieElle est caractérisée par une atteinte de la capacité de dilution-concentration et une diminution de la réabsorption du sodium
- L’action de mécanismes biochimiques faisant intervenir de nombreuses molécules ( PG, facteur atrial natriurétique…)
-
Rôle de l’infection urinaire au cours de l’obstruction
prolifération microbienne va surajouter des lésions de pyélonéphrite aigu’ ou chronique, voire de pyonéphrose. Le parenchyme rénal est alors le siège de lésions irréversibles dont la topographie est fonction du siège du reflux intrarénal des urines infectées.
Lorsque ces lésions guérissent, elles entraînent une sclérose mutilante et rétractile où les structures normales du rein ont disparu.
2-3 INSUFFISANCE RENALE AIGUË PARENCHYMATEUSE
Toutes les structures du rein peuvent être touchées du vaisseau à la papille rénale
L’atteinte tubulaire est le mécanisme le plus fréquent des IRA parenchymateuses.
2-3-1 NECROSE TUBULAIRE AIGUË (NTA)
2-3-1-1 PHYSIOPATHOLOGIE
- L’IRF et la nécrose tubulaire aiguë ischémique représentent un continuum, la première aboutissant à la seconde lorsque l’insuffisance de débit sanguin se prolonge et entraîne la mort cellulaire tubulaire.
Hypoxie médullaire
- Le flux sanguin rénal représente 25 % du débit cardiaque. Il est principalement dirigé vers le cortex afin de préserver la filtration glomérulaire. En revanche, le flux sanguin médullaire est faible pour permettre de préserver le gradient osmotique corticopapillaire.
- Lors d’une baisse significative du débit sanguin rénal, la partie externe de la médullaire qui fonctionne physiologiquement dans un état d’hypoxie chronique relative est plus exposée à une diminution de la tension en oxygène que les structures corticales.
- Ainsi les cellules tubulaires sont la principale cible des lésions de NTA.
- Les médiateurs essentiels de la vasomotricité rénale sont l’endothéline et le NO.
Lésions tubulaires
- La déplétion en ATP et la production de radicaux libres aboutissent à une perte de polarité des cellules du TCP et à une redistribution des intégrines favorisant le détachement de cellules épithéliales dans la lumière tubulaire expliquant l’obstruction. Les polynucléaires neutrophiles et les cellules endothéliales sont largement impliqués dans la physiopathologie des tubulopathies en favorisant la réaction inflammatoire.
- Au cours de la reperfusion après ischémie, l’adhérence des polynucléaires neutrophiles à l’endothélium est augmentée par le biais des molécules d’adhérence (ICAM-1). L’augmentation de la production de radicaux libres après reperfusion participe à la sévérité de la nécrose. L’apoptose ou mort cellulaire programmée peut être mise en jeu dans les cellules tubulaires par des processus identiques à ceux de la nécrose mais en général d’intensité moindre. Elle participe aussi à la genèse de l’IRA.
- Schématiquement, l’origine d’une tubulopathie est ischémique ou toxique. Les 2 facteurs sont fréquemment associés.
Etiologie des nécroses tubulaires aiguës ischémiques
1 Choc hypovolémique par hypovolémie vraie
- Origine extrarénale (diarrhées, vomissements, aspiration gastrique)
- Origine rénale (diurèse osmotique)
- Hémorragie
- Formation d’un troisième secteur (occlusion intestinale, pancréatite, péritonite)
2- Hypoperfusion rénale ou perturbation intrarénale sans hypovolémie
- Choc septique ou allergique
- Modification brutale de l’hémodynamique intrarénale (IEC)
- Choc cardiogénique (infarctus, embolie pulmonaire, péricardite, troubles du rythme )
Tubulopathie d’origine toxique
1 Médicaments
- Produits de contrastes iodés
- Aminoglycoside, Amphotéricine B ,Vancomycine
- Cisplatine
- Immunoglobulines intraveineuses
- Ciclosporine et tacrolimus
- Dextran et hydroxyamidon (Elohes)
2 Intoxication
- Méthanol, Éthylène glycol
- Tétrachlorure de carbone
- Métaux lourds
3 Rhabdomyolyse
- Infectieuse (légionelle, pneumocoque, cytomégalovirus, virus coxsackie)
- traumatique
- médicamenteuse (hypolipémiant, neuroleptique)
- toxique (cocaïne, héroïne)
- avec troubles métaboliques (hypophosphorémie importante, alcool)
- immunologique (polymyosite)
- déficit enzymatique
4 Hémolyse intravasculaire
- Infectieuse (paludisme, septicémie à clostridium perfringens)
- déficit enzymatique (G6PD)
- immunologique (anémie hémolytique-autoimmune)
- mécanique (circulation extracorporelle, valve mécanique)
2-3-2 LES NEPHRITES INTERSTIELLES AIGUËS (NIA)
Les NIA avec IRA sont caractérisées par l’infiltration du tissu interstitiel par des cellules diverses : polynucléaires neutrophiles dans les processus infectieux, cellules mononucléées dans les allergies, cellules néoplasiques dans les cancers .
pas de syndrome bioclinique propre ; leur séméiologie est proche de celle des nécroses tubulaires aiguës.
Etiologies des néphropathies interstitielles aiguës
- Réaction immunoallergique aux médicaments (b-lactamines, AINS, rifampicine) +++
- Infections (brucellose, leptospirose, légionellose, Hantaan virus, mycoplasme)
- Maladie de système (sarcoïdose, syndrome de Sjögren, syndrome NIA-uvéite, lupus, cryoglobulinémie essentielle, …)
- NIA associées aux glomérulonéphrites (notamment vascularite à ANCA)
2-3-3 GLOMERULONEPHRITES AVEC IRA (GNRP)
- définies par un syndrome néphrotique consécutif à une inflammation aiguë du glomérule (réaction immunologique).
- caractérisées par l’association
- d’une protéinurie d’origine glomérulaire (albumine et protéines de plus haut poids moléculaire incluant des IgG),
- d’une hématurie microscopique (globules rouges dysmorphiques en microscopie à contraste de phase) et
- d’une IRA rapidement progressive (avec HTA et œdèmes).
- La biopsie rénale est indispensable permettant de faire le diagnostic et d’établir un pronostic car il faut “opposer” les atteintes glomérulaires inflammatoires endocapillaires qui peuvent rétrocéder complètement aux glomérulonéphrites extracapillaires avec croissants dans lesquelles les lésions ne sont accessibles qu’à un traitement précoce et intensif et qui peuvent aboutir à une insuffisance rénale définitive.
Etiologie des glomérulonéphrites rapidement progressives (GNRP)
1- Avec des dépôts d’anticorps antimembrane basale glomérulaire
- Primaire : syndrome de Goodpasture
- Secondaire (rare) : syndrome d’Alport après transplantation
- Syndrome de chevauchement avec des vascularites systémiques
2- Dépôts granuleux d’IgG de C3
- Agents infectieux (glomérulonéphrites aiguës “post streptococcique”). Les autres agents infectieux sont plus rares.
- Lupus systémique
- Purpura rhumatoïde
- Néphropathie à IgA
- Autres
3- Glomérulonéphrite pauciimmune
- Vascularite systémique à ANCA (Wegener, polyangéïte microscopique, périartérite noueuse, syndrome de Churg et Strauss)
- Autres : polychondrite atrophiante, vascularite rhumatoïde, …
4- Glomérulonéphrite secondaire
- Substances toxiques et solvants organiques (White spirite)
2-3-4 SYNDROME HÉMOLYTIQUE ET URÉMIQUE
Le syndrome hémolytique et urémique est défini par :
- une IRA souvent oligurique installée en quelques jours avec pression artérielle élevée mais parfois normale
- une anémie sévère avec hémolyse mécanique (schizocytes), réticulocytose élevée, haptoglobinémie abaissée et test de Coombs négatif.
- des lésions de microangiopathie thrombotique rénale témoignant d’une activation locale de la coagulation. Elles se traduisent par une thrombopénie et la présence de produits de dégradation de la fibrine.
Circonstances de survenue des microangiopathies thrombotiques
1 Infection intestinale à Escherichia coli sécréteur de vérotoxine ou à shigelle
2 Déficit en enzyme clivant le facteur de Willebrandt
3 HTA maligne
4 Sclérodermie
5 Grossesse
6 Chimiothérapie antinéoplasique (gemcitabine, mitomycine)
2-3-5 INSUFFISANCE RÉNALE AIGUË VASCULAIRE
2-3-5-1 Occlusion des artères rénales
La survenue de l’IRA dans cette circonstance implique que l’obstruction vasculaire soit bilatérale ou unilatérale sur un rein prédominant.
2-3-5-2 L’IRA embolique rénale
Évoquée chez le sujet âgé hypertendu et athéromateux. Le diagnostic est porté par la PBR mettant en évidence des embols de cristaux de cholestérol dans les artères de moyen calibre et les artérioles rénales.
III –MANIFESTATIONS CLINIQUES ET BIOLOGIQUES
3-1 Anamnèse et examen physique
Ne doit pas retarder le diagnostic ni le traitement des complications pouvant mettre en jeu
le pronostic vital : hyperkaliémie, oedème pulmonaire, acidose sévère.
- Anamnèse
- Antécédents :
- créatinine antérieure ;
- rechercher d’éventuels antécédents lithiasiques (coliques néphrétiques) ou néoplasiques (vessie, prostate, col).
- prise médicamenteuse ou injection de produit de contraste ;
- allergie médicamenteuse ;
- maladie générale : HTA, diabète.
- Symptômes précessifs :
- rénaux : douleurs lombaires, pollakiurie, brûlures mictionnelles, hématurie ;
- extra-rénaux :
- généraux : fièvre, anorexie, amaigrissement,
- articulaire, cutané, pulmonaire, etc.
- Anurie ou pas+++ : Facile si le sujet est conscient, l’interrogatoire retrouve l’absence de diurèse depuis plusieurs heures et l’examen clinique ne retrouve aucun globe vésical. Le sondage, s’il est jugé nécessaire, ne ramène que quelques millilitres d’urines
- Antécédents :
- Contexte de survenue :
- L’installation brutale précédée de douleurs de coliques néphrétiques et d’hématurie macroscopique >>>> obstacle ou une obstruction artérielle rénale.
- sujet âgé athéromateux après cathétérisme artériel associée à un livedo cutané à des embols de cholestérol au fond d’œil et à une ischémie aiguë des extrémités >> maladie athéroembolique rénale.
- Une IRA sur rein unique évoque un obstacle ou une sténose artérielle rénale (si IEC)
- Une IRA après chirurgie abdominale évoque une origine infectieuse
- Une IRA après produit de contraste survient au plus tard dans les 48 heures
- Une oligoanurie (< 500ml/j) traduit en général une atteinte plus sévère (IRF, NTA, NIA, GNRP)
- Une anurie n’est pas constante en cas d’IRA obstructive (miction par regorgement, obstacle sur rein prédominant).
- Examen clinique
- Poids.
- État d’hydratation extra-cellulaire.
- Pression artérielle (HTA par hypervolémie parfois), fréquence cardiaque.
- L’examen clinique est dominé par le toucher rectal et vaginal à la recherche d’une infiltration néoplasique du petit bassin. Il doit rechercher aussi l’existence d’un ou deux reins douloureux, d’une tumeur abdominale et noter la présence de cicatrices lombaires ou pelviennes ;Palpation lombo-abomino-pelvienne : recherche de globe vésical, de douleurs lombaires.Touchers
- Auscultation cardio-pulmonaire.
- Bandelette urinaire.
3-2 Evaluation biologique sanguine et urinaire d’orientation
Le bilan minimal comporte
- urine (sur échantillon) : natriurèse, osmolalité, protéinurie, urée et créat, bandelette réactive (hématurie et protéinurie) + ECBU
- sang : osmolalité, urée et créatinine, ionogramme, réserve alcaline, calcium, phosphore, protidémie, glycémie, CPK, numération formule sanguine avec plaquette
L’hyperhydratation intracellulaire est reflétée par l’hyponatrémie tandis que la baisse de l’hématocrite et de la protidémie renseigne sur le degré d’hémodilution.
Orientation diagnostique en fonction des indices urinaires et sanguins
| Indice | IRF | NTA | NIA | GNRP | IRA Obstructive |
| Protéinurie | 0 ou trace | + | + à ++ | ++ à+++ | 0 ou trace |
| Sédiment urinaire | Cylindre hyalin ± | Cylindre granuleux | Cylindre granuleux,GR ± éosinophiles | Cylindre hématique | Cristaux
GR etGB |
| Osmolalité (mosm/Kg) | > 500 | <350 | < 350 | > 500 | > 500 si récent
< 350 si ancien
|
| U/Posm | > 1,5 | < 1,1 | < 1,1 | > 1,5 | > 1,5 si récent,
< 1,1 si ancien |
| NaU mmol/l | < 20 | > 40 | > 40 | < 20 | Variable |
| FENa (%) | < 1 | > 1 | > 1 | < 1 | > 1 |
| Urée U /P | > 8 | < 3 | < 3 | Variable | > 8 si récent, variable si ancien |
| Créat U/P | > 40 | < 20 | < 20 | Variable
(> 40) |
> 40 si récent, variable si ancien |
| Urée/créat P | > 100 | 50 à 100
|
50 (< 100) | variable | > 100 si récent, variable si ancien |
- FENa = excrétion fractionnelle du Na définie par la clairance Na/clairance créatinine.
- Difficulté d’interpréter NaU si diurétiques
- Na/K <1 si IRF , >1 dans les autres situations
- Urée U > 100 mmol/l en cas de NTA évoque un catabolisme protidique important
- Urée U > 200 mmol/l évoque une composante fonctionnelle +++ ,quelle que soit urée sang
- Une protéinurie faible ou nulle à la bandelette et élevée au dosage évoque un myélome.
- En cas de glomérulonéphrite ou de protéinurie +++, bilan immuno (cf : glomérulonéphrite).
IV – DISTINCTION IRA IRC
La distinction entre IRA et IRC repose sur des critères cliniques et des explorations complémentaires; aucun d’entre eux n’est formel.
Critères en faveur d’une IRC devant une « IRA » inexpliquée
1 Petite taille des reins à l’échographie (critère le plus pertinent)
2 Hypocalcémie importante (inférieure à 2 mmol/l)
3 Anémie sévère (inférieure à 90g/l)
4 Absence de facteur déclenchant (cf : étiologie de l’IRA)
5 tolérance clinique relative
6 Contexte familial de néphropathie
7 Chiffres antérieurs de créatinine pathologiques
Pièges diagnostiques
- Insuffisance rénale chronique à reins de grande taille ou de taille normale :
- Polykystose rénale
- Néphropathie diabétique
- Amylose
- La survenue d’une IRA sur une IRC préexistante rend le plus souvent caduque les critères biologiques de différenciation des différents types d’IRA.
V– INTERET DES EXAMENS COMPLEMENTAIRES DANS LE DIAGNOSTIC DES IRA
5-1 ASP
- Evaluation possible du contour des reins et donc de la taille rénale
- Repérage d’un calcul radio opaque (IRA obstructive)
- Calcification aortique et vasculaire importante (terrain athéromateux)
- Visualisation possible de l’opacité vésicale (globe vésical)
- Tassements osseux multiples et lacunes à l’emporte-pièce (myélome)
5-2 Echographie rénale
- Dilatation des voies excrétrices (IRA obstructive)
- Taille des reins et différenciation corticomédullaire (distinction IRA-IRC)
- Globe vésical, tumeur prostatique ou utéroovarienne (IRA obstructive)
- Adénopathies rétropéritonéales (IRA obstructive, fibrose rétro péritonéale,)
- Echo couplée au doppler : Identification d’une sténose artérielle rénale ou évaluation de signes indirects en faveur (accélération du flux, modification des résistances)
- Repérage d’une thrombose vasculaire artérielle ou veineuse
Elle doit contrôler l’ensemble de l’appareil urinaire y compris le pelvis . Elle prime par son innocuité et sa répétitivité
Il faut savoir qu’il existe entre 5 et 20 % de faux positifs quand le bassinet est extra-sinusal ou dans les hydronéphroses et qu’il existe 10 % de faux négatifs où les cavités ne sont pas dilatées.
5-3 Urographie intraveineuse isolée
- Peu contributive dans le cadre de l’IRA et risque néphrotoxique par rapport à l’échographie et au scanner.
- A noter l’intérêt d’une pyélographie descendante lors d’une néphrostomie pour déterminer le niveau d’un obstacle par voie urinaire.
5-4 Scanner
Sans injection de produit de contraste :
- information comparable à celle de l’échographie mais meilleure précision sur l’origine d’un obstacle.
Avec injection de produit de contraste :
- Risque néphrotoxique
- Coût supérieur à l’échographie
- Meilleure évaluation du flux artériel rénal, d’une thrombose artérielle ou veineuse, de la localisation et du type d’obstacle
- Couplage possible avec des clichés d’urographie
5-5 Artériographie
- Nécessité d’une ponction artérielle
- Risque de néphrotoxicité de produits de contraste
- Risque : IRA par embolie de cristaux de cholestérol dans les petits vaisseaux
- Suspicion de thrombose artérielle rénale et éventuellement d’une nécrose corticale
- Dépistage des microanévrismes intrarénaux de la périartérite noueuse
5-5 Scintigraphie rénale
- non invasif mais peu interprétable si IRA sévère
- évaluation globale de la vascularisation (transplantation rénale ou thrombose)
5-6 Biopsie rénale et IRA
Indications
- IRA sans cause évidente (pas de toxique, ni sepsis, ni hypotension)
- Protéinurie abondante et/ou hématurie
- Signes extrarénaux orientant vers une maladie générale ou une vascularite (manifestations articulaires, respiratoires ou cutanées)
- Suspicion de NIA immunoallergique notamment lorsque le médicament suspecté doit être continué
- Installation progressive
- Oligurie ou anurie persistante depuis 2 ou 3 semaines
VI- SIGNES DE GRAVITE D’UNE IRA
1 propres à l’IRA
Détecter les situations d’urgence :
- HTA maligne,
- Anurie avec hyperhydratation extracellulaire importante : nécessite la réalisation d’une radiographie pulmonaire en urgence,
- Hyperkaliémie menaçante : nécessite la réalisation d’un électrocardiogramme,
- Acidose métabolique importante,
1-1 Niveau d’intoxication urémique
- (urée > 50 mmol/l, créatininémie > 1000 µmol/l)
- Confusion, somnolence
1-2 Surcharge hydrosodée :
- > 10 % du poids basal
- œdème aigu du poumon
- épanchements pleuraux
- épanchement péricardique
Cette hyperhydratation est en effet fréquemment iatrogène, provoquée par des apports hydrosodés inadaptés. Elle est souvent accompagnée d’une hyponatrémie, reflet d’une hyperhydratation intracellulaire, du fait du caractère généralement hypotonique des apports.
1-3 Intoxication hydrique
- hyponatrémie < 120 mmol/l
- confusion, coma
1-4 Surinfection ( pneumopathie, sur cathéter ou sonde urinaire)
1-5 Complications hématologiques
- Une anémie se développe le plus souvent dans un délai rapide.
- d’origine multifactorielle : hémolyse, saignement, hémodilution, diminution de la durée de vie des hématies et diminution du taux sanguin d’érythropoïétine synthétisée par le rein, qui survient après 8 à 10 jours d’IRA.
- Une thrombopathie et une hyperleucocytose peuvent être observées.
1-6 Acidose métabolique sévère
- bicarbonatémie < 10 mmol/l
- PH < 7,20
- dyspnée ample, sine materia, peut être observée.
- L’acidémie majore le risque de trouble du rythme cardiaque induit par l’hyperkaliémie et l’hypocalcémie, diminue la contractilité myocardique et diminue la réponse aux catécholamines, ce qui peut la rendre responsable de collapsus cardiovasculaire
1-7 Hyperkaliémie
- potassium > 6 mmol/l
- avec signes électrocardiographiquesimpose
- la réalisation d’un électrocardiogramme en urgence
- ondes T pointues et symétriques, de grande amplitude, un
- allongement de l’espace PR et du QRS,
- >>> blocs de conduction au niveau auriculoventriculaire ou intraventriculaire, voire à une fibrillation ventriculaire.
- L’acidose et l’hypocalcémie potentialisent le risque de trouble de conduction.
1-8 Hyperphosphorémie et hypocalcémie
- phosphore > 3 mmol/l (risque de précipitation intratubulaire, cf chimiothérapie) par défaut d’excrétion rénale et peut être majeure dans les syndromes de lyse tumorale et les rhabdomyolyses
- calcium < 1,8 mmol/l (convulsion, tétanie…) par déficit en vitamine D active 1-25OH2D3 hydroxylée dans le rein
1-9 Complications digestives
- L’hémorragie digestive peut être secondaire à un ulcère de stress ou à une gastrite diffuse dont le saignement est favorisé par la thrombopathie.
1-10 Malnutrition
- Elle peut être rapide et retentir sur le pronostic vital. Elle est secondaire à l’anorexie, à un hypercatabolisme protidique induit par l’acidose et par les maladies notamment infectieuses associées et à une diminution de synthèse protéique.
2 Facteurs de gravité associés à l’IRA
2-1 Age avancé > 65 ans
2-2 Terrain « débilité »
- Diabète,
- Artériopathie,
- Cardiopathie,
- Insuffisance respiratoire
2-3 Défaillance viscérale associée
- Instabilité hémodynamique (choc)
- Défaillance respiratoire (ventilation assistée)
- Etat septique
- Hépatopathie avec insuffisance hépatique)
- Troubles neurologiques (coma, etc…)
- Syndrome hémorragique notamment si thrombopénie
Facteurs prédictifs de mortalité dans l’IRA
- Age >55 ans
- Ventilation assistée
- Diurèse inférieure à 500 ml
- Sepsis
- Bilirubine > 30 µmol/l
Mortalité multipliée par cinq. si 4 ou 5 des facteurs sont présents par rapport aux IRA ayant < 4 facteurs présents
Intérêt des autres scores de gravité (IGSII, APACHE II)
Etiologies des IRA avec hémorragie alvéolaire pulmonaire
- Maladie avec anticorps antimembrane basale glomérulaire (Goodpasture)
- Maladie de Wegener
- Polyangeïte microscopique et Syndrome de Churg et Strauss
- Vascularite lupique pulmonaire
- Choc cardiogénique sur embolie pulmonaire sévère
- Œdème aigu pulmonaire important (surcharge hydrosodée)
- Légionellose avec néphrite interstitielle ou rhabdomyolyse
VII- DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUES
1- Première étape : rechercher un obstacle
- Toute IRA doit faire pratiquer une échographie rénale à la recherche d’un obstacle
- ECBU
- ASP et TDM C-
- drainage + opacification
2- Deuxième étape : rechercher une cause fonctionnelle
- L’interrogatoire recherche des causes de déshydratation extracellulaire, d’hypovolémie efficace, de vasodilatation systémique et recherche la prise d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et d’AINS. Tout état de choc peut par ailleurs induire une IRF.
- L’examen clinique recherche des signes d’hypovolémie (hypotension, hypotension orthostatique, tachycardie) associés à un pli cutané en cas de déshydratation extracellulaire.
- Le ionogramme urinaire montre que la réponse rénale est adaptée à l’hypoperfusion puisqu’elle limite les pertes d’eau et de sel sous l’effet de la sécrétion d’angiotensine II et de vasopressine
3- Troisième étape : suspecter une nécrose tubulaire aiguë
- Ayant éliminé une insuffisance rénale fonctionnelle et un obstacle, nous sommes donc dans le cadre des insuffisances rénales intrinsèques ou parenchymateuses. L
VII- PRINCIPES DU TRAITEMENT DES IRA
notions capitales :
1- la récupération de la fonction rénale est meilleure lorsque la diurèse est conservée, témoignant de lésions rénales moins sévères.
2- plus l’action thérapeutique est précoce, meilleur est le pronostic rénal et vital soulignant ainsi le bénéfice des mesures prophylactiques.
1- COMPLICATIONS DE L’IRA
a) Hyperhydratation extra-cellulaire :
Complique surtout les formes oligo-anuriques :
- diététique : restriction hydrique < 500 ml/j, et sodée 4 g/j;
- diurétique de l’anse : furosémide à fortes doses ;
- en cas d’échec et de persistance d’une anurie dans les 24 heures, indication d’épuration extra-rénale avec ultrafiltration.
b) Acidose métabolique
- À corriger si elle est décompensée ou en cas de retentissement clinique.
- Nécessité de corriger au préalable une hypocalcémie, car risque d’aggravation.
- En l’absence d’une insuffisance cardiaque congestive ou d’un oedème pulmonaire :
- perfusion de bicarbonate de sodium.
- Si elle est sévère : (bicarbonate ≤ 10 mmol/l), indication d’épuration extra-rénale par hémodialyse.
c) Hyperkaliémie
si des signes électrocardiographiques existent, le traitement d’urgence repose sur des manoeuvres à effet immédiat, sans modification du stock potassique, mais corrigeant le potentiel de membrane de la cellule myocardique ;
- soit en diminuant le potassium extracellulaire par transfert dans la cellule ; trois thérapeutiques peuvent être employées dans ce sens :
- alcalinisation par injection de bicarbonate de sodium isotonique ou semi-molaire, seulement si l’état d’hydratation du patient le permet ;
- injection par voie intraveineuse d’insuline conjointement à du sérum glucosé à raison de 1 UI d’insuline ordinaire pour 5g de glucose, soit par exemple 30UI d’insuline pour 500 mL de G 30%;
- administration de bêta-2-stimulant tel que le salbutamol, soit par voie intraveineuse, soit par voie nasale, surtout utilisée en pédiatrie ;
- soit en contrebalançant l’effet de l’excès de potassium par du calcium (10 à 20mL de gluconate de calcium à 10 % en intraveineux lent). Cette mesure ne doit toutefois pas être appliquée au patient sous digitalique.
Ces thérapeutiques n’ont qu’un effet temporaire et devront être rapidement suivies de mesures visant à diminuer le stock potassique : résines échangeuses de cations type Kayexalate (15 à 90 g/j par voie orale ou 60 à 100 g par lavement) et hémodialyse en urgence.
d) Correction d’une hypocalcémie et d’une hyperphosphorémie
Administration de carbonate de calcium.
Ces troubles seront efficacement corrigés en cas d’instauration d’épuration extra-rénale.
Epuration extra rénale
1 Objectifs principaux
- Suppression de la symptomatologie liée à l’urémie sévère (maintenir l’urée inférieure à 30 mmol/l)
- Correction de la surcharge hydrosodée (connaître poids de référence avant IRA)
- Contrôle de l’équilibre acidobasique (maintenir le bicarbonate supérieur à 20 mmol/l)
- Contrôle de la kaliémie
- Contrôle de l’équilibre phosphocalcique
- Maintien d’un état nutritionnel satisfaisant en respectant les besoins caloriques de 30 à 50 Kcal/Kg/jour en fonction du catabolisme protidique.
2 Moyens
- Hémodialyse intermittente
- Hémodialyse continue (en cas d’instabilité hémodynamique)
- Dialyse péritonéale intermittente ou continue en l’absence d’intervention abdominale
3 indications
Dans les contextes d’IRA sévères, anuriques, avec les manifestations suivantes :
- Hyperhydratation extra-cellulaire avec oedème pulmonaire, HTA sévère.
- Hyperkaliémie symptomatique (cliniquement ou anomalies électriques).
- Acidose métabolique sévère (bicarbonate < 10 mmol/l, pH < 7,2).
- Rétention azotée majeure. taux d’urée supérieur à 40 mmol/L ;
- une créatininémie supérieure à 1000 ímol/L ;
- un retentissement clinique du syndrome urémique
- vomissements, syndrome hémorragiqu
- Présence de troubles neuropsychiques d’apparition récente :
- l’hémodialyse est la méthode utilisée dans les situations d’urgence. L’accès vasculaire est obtenu après implantation de cathéters veineux profonds : fémoral ou jugulaire interne
- la première séance doit être brève (2 heures) pour éviter des troubles neurologiques graves liés à la correction trop rapide des troubles hydroélectrolytiques.
2- TRAITEMENT ETIOLOGIQUES :
1 Insuffisance rénale fonctionnelle
1-1 Correction de l’hypovolémie vraie pour restaurer l’hémodynamique rénale avec des perfusions de soluté salé ou de soluté colloïde
évaluer la perte pondérale
1-2 Correction de la cause en cas d’hypoperfusion rénale sans hypovolémie
- Insuffisance cardiaque: tonicardiaques, diurétiques
- Syndrome néphrotique : traitement étiologique
- Sepsis : antibiothérapie et maintien de l’hémodynamique par des drogues vasoactives si nécessaire (dobutamine, dopamine, noradrénaline)
1-3 Méthodes d’expansion volémique :
- Le sérum salé physiologique est recommandé en cas de déshydratation extracellulaire pure
- L’albumine a un pouvoir d’expansion volémique de 100 % et une durée d’expansion volémique prolongée de plus de 8 h. Le coût est cependant élevé.
- Les gélatines fluides modifiées ont une durée d’expansion identique mais peuvent être à l’origine de réactions allergiques.
- Les dextrans (polymère de glucose) ont un pouvoir d’expansion volémique supérieur au volume perfusé, peuvent être responsables de réaction allergique et interfèrent avec l’hémostase.
- Les hydroxyéthylamidons (Elohes) ont un pouvoir d’expansion de 150 % du volume perfusé, peuvent engendrer des réactions anaphylactiques. Le risque essentiel est une thésaurismose notamment rénale avec insuffisance rénale chronique définitive. Celle-ci est liée au caractère hautement substitué des polysaccharides de haut poids moléculaire.
2 Insuffisance rénale obstructive
2-1: symptomatique
- Dérivation basse par sonde en cas d’obstacle pelvien prostatique (parfois suspubien si prostatite)
- Dérivation interne pas endoscopie (sonde en double J ou urétérale si sg ou pus)
- mise en place transitoire de sonde de néphrostomie.
- soit quelquefois par chirurgie conventionnelle : urétérostomie cutanée uni- ou bilatérale en cas de cancer pelvien, néphrostomie chirurgicale exceptionnellement
Surveillance :
- Les paramètres cliniques sont : le pouls, la tension artérielle, la pression veineuse centrale si le patient est porteur d’une voie veineuse centrale, la diurèse, la densité urinaire mesurée au lit du patient, l’état d’hydratation et le poids.
- Les éléments biologiques sont l’urée et les ionogrammes sanguins et urinaires, l’hématocrite, la protidémie et s’il y a lieu, la glycémie et la glycosurie.
2-2 risques de syndrome de levée d’obstacle
- Patient ayant des troubles de conscience
- Un apport large de sérum physiologique parentéral est prescrit , par exemple 3 litres par 24 heures.
- La diurèse ne sera compensée que s’il apparaît des signes de déshydratation et d’hypovolémie
- Le soluté de compensation est choisi en fonction des résultats des ionogrammes ,sanguins et urinaires.
- Dans de telles situations nécessitant des compensations, la polyurie peut être pérennisée par la compensation elle-même. La baisse de l’urée sanguine et une densité urinaire inférieure à 1007 sont deux indicateurs qui autorisent la diminution puis l’arrêt de la compensation.
- Patient conscient capable de boire
- Il faut réaliser un apport parentéral large de sérum physiologique d’environ 3 litres par 24 heures associé à des boissons libres. En buvant à leur soif, les patients se régulent d’eux-mêmes et ajustent leur bilan hydrique et leur natrémie. Les apports intra-veineux seront interrompus quand l’urée aura diminué suffisamment.
- l’existence d’un syndrome septique impose de débuter sans délai une antibiothérapie probabiliste Les posologies initiales sont calculées initialement en fonction du poids chez un patient considéré comme anurique. L’adaptation ultérieure dépend des dosages sanguins des antibiotiques (taux résiduels) plus que du calcul de la clairance de la créatinine puisque cette dernière se modifie.
- L’absence de reprise de la diurèse impose de ralentir les apports au minimum et de vérifier la perméabilité ainsi que le bon positionnement des drainages.
- les patients diabétiques sont susceptibles de décompenser leur diabète.
- en cas d’insuffisance rénale préalable à l’obstacle, le taux d’urée diminue beaucoup moins vite que sur des reins antérieurement sains. Les dangers d’un SLO sont paradoxalement moins grands car les corrections biologiques ne seront pas brutales.
- risque de thrombose veineuse dans ce contexte qui peut associer divers facteurs favorisants : sujet âgé, néoplasie du petit bassin, diminution de la mobilité par la présence des sondes, déshydratation ou hypoprotidémie.
2-3: étiologique
- néoplasique :
- prostate :
- castration chirurgicale ou chimique
- Il est quelquefois possible, par résection endoscopique et injection de bleu de méthylène par la néphrostomie, de repérer l’orifice et de monter une sonde urétéral
- L’urétérostomie cutanée bilatérale et l’urétérostomie avec ou sans sonde gardent leurs partisans. L’abstention thérapeutique peut être raisonnable.
- Le pronostic n’est toutefois pas si péjoratif que cela. En effet, la survie peut être supérieure à un an dans 70 % des cas lorsque l’anurie est révélatrice, elle n’est malheureusement que de 30 % des cas lorsque le cancer est déjà connu
- vessie : stade avancé, possible de tenter l’élégante association résection endoscopique – sonde en double J par voie antérograde. Cependant le plus souvent une cysto-prostatectomie avec dérivation urétérale par Bricker ou une urétérostomie cutanée restent la seule possibilité. , voir abstention. Le pronostic est sombre, la survie moyenne est de 7 mois avec une hospitalisation moyenne de 27 jours
- génitaux (utérus et col)et rectum : La survie de ces cancers récidivant en anurie est inférieure à 6 mois souvent dérivation urinaire jusqu’au décès du malade.
- prostate :
Dans tous les cas les diurétiques sont contre-indiqués s’il existe un obstacle.
3 Insuffisance rénale organique
- Suppression et correction du facteur déclenchant (toxique, médicament, correction de l’hypovolémie)
- Utilisation de diurétiques de l’anse (FUROSEMIDE 10 à 20 mg/kg) pour transformer une IRA oligurique en une forme à diurèse conservée afin de faciliter la balance hydrique.
- La dopamine à faibles doses inférieure à 3 µg/Kg/min n’a pas fait la preuve de son efficacité.
- L’hyperkaliémie se traite par des résines échangeuses d’ions :KAYEXALATE (environ 50 g/mEq de kaliémie en trop) et/ou la dialyse
- La correction de l’acidose métabolique comporte la mise en jeu des moyens permettant de traiter la cause, le maintien d’une ventilation alvéolaire adéquate pour favoriser l’élimination pulmonaire du CO2 et la dialyse.
- L’apport de substances tampons ou d’alcalinisants n’est justifié que dans de rares indications spécifiques : pertes excessives de bicarbonate, acidose métabolique associée à une hyperkaliémie ou au cours d’une intoxication par des produits à effet stabilisant de membrane
5 Particularités de l’IRA en cours d’une grossesse
- IRA avec prééclampsie: repos, traitement antihypertenseur, déclenchement ou césarienne si syndrome toxémique sévère ou mal contrôlé
- Stéatose aiguë gravidique et Hellp syndrome: délivrance
- microangiopathie et nécrose corticale: Délivrance, recherche d’anomalie de l’hémostase. Prise en charge en dialyse prolongée voire définitive
- Risque d’IRA plus élevé dans les pyélonéphrites gravidiques
IX – PREVENTION DES IRA
L’IRA représente environ 1 % des causes d’admission hospitalière dont 20 % sont liées aux médicaments
Facteurs prédisposant l’IRA médicamenteuse
- Sujet âgé
- Déplétion sodée
- Insuffisance cardiaque congestive
- Insuffisance rénale chronique préalable
- Diabète
- Cirrhose avec ascite
- Syndrome néphrotique
- Association à d’autres médicaments néphrotoxiques
- Prescription prolongée
Arguments suggérant une néphrotoxicité directe médicamenteuse
- Relation dose et apparition de premiers signes rénaux
- Absence de manifestation clinique extra rénale
- Concentration sanguine élevée du médicament
- Absence d’anomalie immunologique
- Atteinte tubulaire prédominante à la biopsie si elle est réalisée
- Médicaments concernés essentiellement : (aminoglycosides, amphotéricine B, produits de contraste, sel de platine)
Arguments suggérant une IRA immunoallergique
- Absence de relation dose effet
- Manifestations générales associées (fièvre, éruption arthralgies cytolyse hépatique)
- Réapparition de la symptomatologie avec réintroduction du médicament
- Atteinte interstitielle prédominante
CONCLUSION
La prévention de la néphrotoxicité médicamenteuse est donc réalisée par :
- La prise en compte des facteurs prédisposant l’IRA
- La limitation des médicaments à néphrotoxicité dose dépendante (produits de contraste) notamment en cas d’IRC ou de diabète
- La réduction des doses
- La limitation dans le temps
- La mesure de la concentration sérique des médicaments néphrotoxiques.
L’anurie par obstacle est une urgence néphro-urologique dont les causes les plus fréquentes sont la lithiase et l’envahissement urétéral néoplasique. Il faut dépister des troubles métaboliques nécessitant une épuration extra rénale en urgence. L’échographie rénale permet de confirmer le diagnostic. Le traitement en urgence est le drainage des voies excrétrices qui sera suivi à distance du traitement de la cause.
PREVENTION : surveillance des malades lithiasiques, nephrectomisé, ttt des cancers pelviens